🗞 L'actualité sociale et RH - Avril 2025
# 46 - Les enseignements pratiques des derniers arrêts pour affûter vos réflexes RH
Au programme de cette édition :
✅ Inaptitude : deux rappels pratiques pour sécuriser vos procédures RH en cas de contestation de l’avis médical ou d’inaptitude d’origine professionnelle.
👔 Cadre dirigeant : quand la réalité des fonctions ne colle pas avec les mentions du contrat de travail. Quels sont les risques RH et financiers pour l’entreprise ?
💔 Dépit amoureux et faute grave : jusqu’où s’étendent les limites entre vie privée et vie professionnelle ?
💊 Arrêts maladie : les nouvelles règles d’indemnisation sont en vigueur depuis le 1er avril. Moins d’IJSS = plus de charge pour l’entreprise. On fait le point avec un exemple chiffré.
⏱️ Temps de lecture : 15 minutes
Pour vous inscrire et ne rien rater des prochaines éditions, c’est par ici 👇 :
👉 Vous pouvez accéder à plus de mes publications en cliquant ici, ou me retrouver sur Linkedin.
👉 Et si vous pensez que ces éditions pourraient intéresser d’autres personnes, n’hésitez pas à partager :
Avant de démarrer, je vous partage une ressource qui pourrait vous intéresser. Elle est réalisée par Lucca, Sponsor de l’édition du jour :
Congés SYNTEC : 18 fiches pratiques pour maîtriser le cadre légal et conventionnel
Les équipes Lucca ont rédigé un guide pratique dans lequel elles détaillent les règles applicables en matière de congés légaux et les spécificités de la convention collective SYNTEC.
Vous y découvrirez 18 fiches pratiques pour appréhender des notions fondamentales telles que :
✅ Les congés spéciaux
✅ Les règles de calcul
✅ La gestion courante
✅ Les moments clés (comme le solde de tout compte)
Une ressource clé pour bien anticiper la gestion de l’ensemble de ces sujets. Pour télécharger le guide, cliquez sur ce lien.
Bonjour tout le monde,
J’espère que votre mois d’avril a bien commencé. Bienvenue aux 150 nouveaux abonnés qui nous ont rejoints depuis la dernière édition !
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voulais partager avec vous un podcast enregistré avec Alexis Eve, CEO de Yaniro. On y parle de ma vision pour réconcilier les chiffres et la fonction RH. Oui, c’est un thème récurrent ici, mais ce format permet de prendre un peu de hauteur et d’aborder le sujet autrement.
👉 Si ça vous tente, l’épisode est disponible ici. Comme toujours, vos retours sont les bienvenus !
Mais revenons à l’actualité RH. Ces dernières semaines, plusieurs décisions importantes de la Cour de cassation apportent des éclairages utiles pour sécuriser vos pratiques : statut de cadre dirigeant, formalisme à respecter en cas d’inaptitude, conséquences d’un comportement inapproprié entre collègues, ou encore nouvelles règles d’indemnisation en cas d’arrêt maladie.
Comme toujours, je les ai analysées pour vous aider à en tirer les enseignements concrets côté RH, paie ou gestion financière.
Je vous souhaite une lecture enrichissante !
🎯L’objectif de ce format : revenir sur des décisions de justice et des nouveautés réglementaires ayant marqué l’actualité des dernières semaines, pour vous en expliquer leur portée RH, administrative et/ou financière. En bref, vous permettre de mieux appréhender les conséquences opérationnelles du droit pour vous aider à adapter votre pratique RH face à ces nouveautés.
🔔 Et pour encore plus de contenus, vous pouvez me retrouver sur Linkedin où je publie chaque semaine infographies et news sur les sujets liant RH, paie et finance !
❌ Inaptitude : quel formalisme respecter pour sécuriser vos procédures ?
Le mois dernier, j’évoquais déjà deux arrêts rendus en matière d’inaptitude, au sujet des obligations en matière de recherche de reclassement et de reprise du paiement des salaires. J’y reviens une nouvelle fois avec deux arrêts traitant cette fois-ci des conséquences de la contestation de l’arrêt médical par le salarié et de la consultation du CSE avant l’entretien préalable au licenciement.
1️⃣ Contestation de l’avis médical : l’employeur peut poursuivre la procédure
Dans cet arrêt (Cass soc., 19 mars 2025, n°23-19.813), un salarié avait été recruté par l’entreprise réseau de transport d’électricité (RTE) en décembre 2017. Reconnu travailleur handicapé, il avait bénéficié d’un aménagement de poste validé par le médecin du travail.
Puis, en août 2018, le salarié est déclaré inapte à tout emploi. L’avis médical est clair :
« L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Cette mention dispensant l’employeur de rechercher d’éventuels postes de reclassement en application de l’article L1226-2-1 du Code du travail, il initie la procédure de rupture du contrat pour inaptitude.
Mais le salarié conteste en parallèle les conclusions de l’avis médical devant le Conseil de prud’hommes.
Sans attendre la décision des juges prud’homaux, l’employeur prononce la rupture du contrat pour inaptitude (pour être précis, il s’agit d’une rupture du stage statutaire, le salarié relevant du régime des industries électriques et gazières).
En conséquence, le salarié décide de contester son licenciement : selon lui, l’entreprise aurait dû attendre que le Conseil de prud’hommes statue sur la validité de l’avis médical avant de rompre le contrat. Il soutient également que son employeur n’a pas suffisamment justifié de l’impossibilité de le maintenir dans un emploi.
➡️ La Cour d’appel lui donne raison. Mais la Cour de cassation casse la décision.
Pourquoi ?
Elle considère tout d’abord que l’avis d’inaptitude du médecin du travail était régulier et précis. De plus, elle précise que l’employeur n’est pas tenu d’attendre la décision prud’homale pour engager la procédure de rupture. Enfin, dès lors que l’avis mentionne que « l’état de santé fait obstacle à tout reclassement », l’obligation de reclassement ne s’applique plus.
💡 À retenir côté RH : La procédure d’inaptitude peut être poursuivie sans attendre la décision prud’homale, cette dernière "n’étant pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud’hommes sur le recours formé contre l’avis du médecin du travail".
2️⃣ Inaptitude d’origine professionnelle : consultation obligatoire des représentants du personnel
Le second arrêt (Cass. soc., 5 mars 2025 n°23-13.802) concerne un conducteur routier déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail et d’une longue période de rechute. L’employeur n’envisage aucune possibilité de reclassement, notamment en raison de l’absence de mobilité géographique du salarié. Il engage donc une procédure de licenciement… mais sans consulter au préalable les représentants du personnel (CSE). Il les consulte cependant in extremis juste avant de prononcer le licenciement du salarié.
➡️ Le salarié conteste son licenciement et la Cour de cassation lui donne raison.
Pourquoi ?
Les juges rappellent qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’article L.1226-10 du Code du travail impose la consultation préalable des représentants du personnel, même si aucun poste de reclassement n’a été identifié.
L’argument selon lequel « il n’y avait pas de solution de reclassement, donc pas besoin de consulter » est inopérant : la consultation reste une étape obligatoire avant d’engager la rupture, bien que l’article ne le précise pas explicitement. En effet, ce dernier indique que la proposition de reclassement "prend en compte, après avis du CSE, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise”.
Ainsi, même si l’inaptitude semble « sans solution », ne sautez pas la case consultation ! En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, cette étape est impérative, y compris si le reclassement est manifestement impossible. Dans une telle situation, je rédige une note à destination des membres du CSE expliquant la situation du salarié et détaillant l’avis d’inaptitude en rappelant que le Code du travail impose la consultation préalable du CSE, même si des solutions de reclassement semblent inenvisageables et je fais acter, au procès-verbal, que le sujet a été abordé en indiquant les observations éventuelles des représentants du personnel.
💡 Ce qu’on en retient côté RH
Ces deux arrêts illustrent la vigilance dont il faut faire preuve dans la gestion des inaptitudes :
Le contenu précis de l’avis médical peut totalement conditionner la suite de la procédure ;
Les formalités comme la consultation des représentants du personnel restent incontournables selon l’origine de l’inaptitude ;
Et surtout : ce n’est pas parce qu’aucune solution de reclassement n’est identifiée qu’on peut faire l’impasse sur les obligations légales.
💡 Un bon réflexe RH : Toujours échanger avec le médecin du travail en amont, pour obtenir un avis le plus clair possible, et bien documenter chaque étape (consultation, recherches de reclassement, etc.) avant de lancer la convocation à entretien préalable. C’est la clé pour sécuriser la procédure et éviter des condamnations coûteuses en cas de contentieux.
🧑💼 Cadre dirigeant : ce n’est pas le contrat qui compte mais la réalité des fonctions
La notion de "cadre dirigeant" est souvent utilisée pour exclure certains salariés d’une grande partie de la législation relative au suivi et au décompte du temps de travail. Mais pour que cette qualification soit valable, encore faut-il respecter trois critères cumulatifs définis par le Code du travail.
Dans un arrêt du 5 mars 2025 (Cass. soc., 5 mars 2025, n°23-23.340), la Cour de cassation rappelle que la seule mention du statut de cadre dirigeant dans le contrat de travail ne suffit pas. Il convient de démontrer que le cadre est effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome.
📖 Retour sur les faits : un statut contesté après un licenciement
Le salarié est embauché en 2007 comme responsable maintenance. Il gravit les échelons jusqu’à devenir, en 2016, directeur achats de la division ferroviaire d’un grand groupe industriel. Il est classé "cadre III C", et son contrat précise qu’il a le statut de cadre dirigeant. Il figure aussi dans les cercles de management du groupe, comme le « Management Circle ».
Licencié pour faute grave en 2018, il saisit les prud’hommes et conteste son statut. Il réclame notamment :
le paiement d’heures supplémentaires,
des congés payés afférents,
une indemnité compensatrice de repos,
des dommages-intérêts pour harcèlement moral,
des rappels de rémunération variable.
La cour d’appel rejette ses demandes, estimant qu’il avait bien la qualité de cadre dirigeant. Mais la Cour de cassation casse l’arrêt partiellement.
⚖️ Position de la Cour de cassation : les critères du cadre dirigeant doivent être démontrés concrètement
La Cour rappelle que la qualification de cadre dirigeant impose trois conditions cumulatives (article L. 3111-2 du Code du travail) :
Une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps ;
Une large autonomie dans la prise de décision ;
Une rémunération dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.
Et surtout : ces éléments doivent être établis concrètement par l’employeur, au-delà des mentions contractuelles.
Or, pour débouter le salarié de ses demandes, la Cour d’appel considérait que le statut de cadre dirigeant reposait sur des éléments solides :
la participation du salarié aux instances de direction,
sa position dans l’organigramme,
son niveau de classification,
Cependant elle n’a pas démontré que le salarié disposait réellement d’une large autonomie de décision dans ses fonctions ni qu’il participait activement à la stratégie de l’entreprise. Et ce point semblait difficile à défendre car le salarié soutenait qu’il avait voulu définir des plans d’actions mais qu’il avait manqué d’autonomie et de ressources pour le faire et qu’il n’était pas impliqué dans l’initiative des projets.
Résultat : la Cour de cassation désavoue les juges d’appel considérant qu’ils n’avaient pas suffisamment caractérisé que le salarié profitait d’une large autonomie dans l’exercice de ses fonctions l’amenant à participer à la direction de l’entreprise.
💡 À retenir côté RH : un statut qui ne repose pas sur des déclarations mais sur la réalité du pouvoir exercé
Cet arrêt est un bon rappel pour les directions RH : la qualité de cadre dirigeant ne peut pas être une simple clause contractuelle. Il faut pouvoir prouver que la personne :
prend des décisions stratégiques,
organise librement son emploi du temps,
perçoit une rémunération réellement parmi les plus élevée de l’entreprise
et participe activement à la direction de l’entreprise.
Dans les faits, cela ne peut concerner que quelques salariés au sein d’une même organisation.
Si ces conditions font défaut, le salarié pourra revendiquer l’application des dispositions classiques en matière de décompte du temps de travail : décompte du temps de travail sur une base horaire, paiement d’heures supplémentaires, repos compensateurs éventuels…
💰 Quel risque en cas d’erreur ?
Dans ce dossier, la reconnaissance de la qualité de salarié "à l’horaire" pourra ouvrir droit à :
des rappels d’heures supplémentaires sur les trois années précédant la rupture du contrat
une indemnité de congés payés afférente,
d’éventuelles contreparties obligatoires en repos si les rappels d’heures supplémentaires dépassent les limites du contingent annuel
Comme pour les forfaits jours, c’est la pratique réelle qui prime, et non l’intitulé contractuel. Une requalification peut coûter cher. Pensez donc à réaliser régulièrement un audit de vos pratiques afin de vérifier que la réalité des fonctions répond bien aux exigences rappelées dans cet arrêt.
Cela évitera de mauvaises surprises en cas de rupture conflictuelle du contrat de travail car, comme je le répète souvent : ce n’est pas parce que la rupture du contrat est fondée qu’il n’existe pas de risque sur l’exécution du contrat de travail, décompte du temps de travail en tête.
💔 Vie privée et entreprise : quand les conséquences d’un dépit amoureux justifie un licenciement pour faute grave ?
Les juridictions sont régulièrement saisies de litiges mêlant vie personnelle et relations professionnelles. Un salarié peut-il être licencié pour avoir tenté de renouer un lien avec une collègue, lorsque cette tentative interfère avec le cadre de travail ?
La Cour de cassation a tranché, dans un récent arrêt du 26 mars 2025 (Cass soc. 26 mars 2025, n°23-17.544), en validant le licenciement pour faute grave d’un salarié en raison d’un comportement insistant né pourtant d’une relation initialement privée.
📖 Retour sur les faits : une rupture sentimentale, un comportement déplacé sur le lieu de travail
Le salarié est embauché en 1985 par l’Afdas. En fin de carrière, il occupe un poste à responsabilités : directeur des partenariats et des relations institutionnelles.
En juillet 2017, il est licencié pour faute grave.
L’origine du conflit ? Une relation sentimentale nouée avec une collègue. Après leur rupture, l’homme multiplie les messages à destination de la salariée, notamment via la messagerie professionnelle. Il tente de renouer le dialogue malgré le refus clair de la salariée qui souhaite s’en tenir à une relation strictement professionnelle.
Devant l’insistance de ce dernier, elle décide de parler de la situation au médecin du travail qui alerte l’employeur. Devant la détresse de sa salariée et dans le but de faire cesser ces agissements, l’entreprise décide de licencier le cadre dirigeant. Une décision non sans risque car ce dernier compte alors 32 ans d’ancienneté et d’une rémunération mensuelle de 8363 euros brut (les demandes du salarié au titre de l’indemnité conventionnelle et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’élevaient, en appel, à 450 000 euros).
Le courrier de licenciement est intéressant car il nous fournit quelques éléments concrets quant à la nature des échanges : il indique que le salarié n’a eu de cesse d’importuner la collaboratrice par de nombreux moyens : SMS, Whatsapp, appels téléphoniques, aussi bien sur son téléphone portable que sur la ligne fixe personnelle, messagerie professionnelle, messagerie personnelle et Sametime. Il liste d’ailleurs le nombre et les heures des appels et messages en citant quelques extraits :
« silence + indifférence = mort » ;
« j'arrive car trop inquiet » (avec l'adresse personnelle de la collaboratrice);
« Que trépasse si mon coeur faiblit' les épreuves ne font pas peur car mes sentiments sont plus forts que tout' » ;
« Si comportement = mes appels téléphoniques intempestifs + mes écrits = JALOUSIE! » ;
« C'est vraiment toi qui réponds là' J'en suis pas sûr ! Si c'est vous M. Aa, je ne vous crains pas ! Si vous êtes un homme, confrontez-vous à moi' » ;
« Je suis devenu un virus et un spam pour toi' » ;
« Pardon' pardon' pardon' ».
Face à cette décision, le salarié conteste, avançant qu’il s’agit d’un fait relevant de sa vie personnelle, et qu’un fait de la vie personnelle, même s'il occasionne un trouble dans l'entreprise, ne peut justifier un licenciement disciplinaire
⚖️ Position de la Cour de cassation : un comportement relevant de la vie privée peut devenir fautif s’il trouble le cadre professionnel
La Cour rappelle un principe classique :
« Un fait tiré de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.»
Mais ici, le comportement litigieux s’est prolongé sur le lieu et le temps de travail, via des canaux professionnels, malgré un refus explicite de la salariée. Et ce comportement :
✅ a été jugé intrusif et persistant,
✅ s’est accompagné d’un usage de la position hiérarchique du salarié (même s’il n’existait pas de lien de subordination directe entre le cadre dirigeant et la salariée),
✅ a eu des répercussions avérées sur la santé de sa collègue (attestées par le médecin du travail et sa manager).
La Cour conclut que ces faits constituent un manquement aux obligations contractuelles, notamment celle de préserver la santé et la sécurité d’autrui au travail (article L. 4122-1 du Code du travail).
Dès lors, le licenciement pour faute grave est justifié, même s’il n’est pas formellement qualifié de harcèlement moral dans la lettre de licenciement.
💡 Leçons à tirer pour les RH : vie privée ≠ impunité au travail
Ce que nous enseigne cet arrêt :
Une relation privée ne protège pas de toute sanction si elle a des conséquences dans le cadre professionnel
Le comportement post-rupture est ici au cœur du débat : l’usage de la messagerie professionnelle, les sollicitations insistantes et la pression ressentie par l’autre salariée suffisent à justifier la sanction.
La qualité hiérarchique du salarié a pesé dans l’appréciation de la gravité : en tant que membre du comité directeur, il aurait dû faire preuve d’une retenue exemplaire.
L’entreprise a appuyé sa décision sur des éléments médicaux et managériaux objectifs : c’est ce qui a permis de faire reconnaître la faute grave.
Ces faits fournissent une illustration intéressante de la manière dont l’entreprise peut gérer une telle situation en s’appuyant, notamment sur le respect de l’article L4122-1 du Code du travail et ce, sans que soit caractérisé de harcèlement moral ou sexuel.
📉 Arrêts maladie : quel impact sur les coûts RH ?
C’est une mesure qui risque désormais de peser lourd dans les comptes des entreprises. Depuis le 1er avril 2025, le gouvernement a abaissé le plafond applicable au calcul des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) en cas d’arrêt maladie.
Cette mesure entraîne une baisse du montant maximal des IJSS versées : pour déterminer le montant des IJSS à verser à un salarié, la Sécurité sociale calcule un salaire journalier de référence en prenant la moyenne des trois derniers mois de salaire dans la limite d’un plafond.
Jusqu’ici, ce plafond était fixé à 1,8 fois le SMIC mensuel brut, soit 3243 €.
Il est désormais abaissé à 1,4 fois le SMIC, soit 2522 €.
Conséquence, le montant maximal journalier d’une IJSS est désormais plafonné à 41,47 euros (contre 53,31 euros auparavant).
💰 Quelle conséquence financière pour les entreprises ?
Cette baisse du plafonnement a une incidence pour les salariés gagnant plus de 2522 euros brut. En cas d’arrêt maladie, ces derniers verront leur niveau d’indemnisation baisser.
Cependant, la majorité des entreprises maintiennent tout ou partie du salaire en cas d’arrêt maladie du fait de l’application de garanties conventionnelles. Et ce complément de salaire versé par l’employeur vient compléter les indemnités versées par la Sécurité sociale.
➡️ Conséquence : si les IJSS diminuent, la part à la charge de l’entreprise augmente.
Je vous ai illustré l’impact dans l’infographie ci-dessous pour un salarié gagnant 4000 euros brut / mois.
🧮 Un effet direct sur la masse salariale et les équilibres budgétaires
Cette évolution intervient dans un contexte où les absences maladie sont déjà en hausse dans de nombreux secteurs. Pour les entreprises, cela signifie :
des coûts de maintien de salaire en augmentation, notamment pour les cadres
une nécessité accrue d’anticiper les impacts RH et budgétaires des arrêts longue durée ;
un réexamen possible des dispositifs de prévoyance ou des accords collectifs prévoyant des garanties de maintien de salaire.
💡 Si vous souhaitez approfondir ces évolutions et leurs conséquences RH, juridiques et financières, je vous conseille 👉 ce book concret et pédagogique réalisé avec Jean-Julien Jarry.
Merci d’avoir lu cette édition. Je suis toujours preneur de vos retours ! Si vous avez 2 minutes, n’hésitez pas à répondre à cette question et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a intéressé et ce qui vous a moins plu. Cela m’aidera à améliorer le contenu et à continuer. Merci ! 🙏
Et pour continuer d’approfondir le sujet, n’hésitez pas à m’envoyer un message à vincent.hagenbourger@gmail.com ou à me laisser un commentaire ici.
Vous pouvez aussi me retrouver sur Linkedin pour suivre toutes mes publications.
Et si vous pensez que le sujet peut intéresser d’autres personnes, n’hésitez pas à partager !
À bientôt pour de nouveaux articles liant chiffres & RH !
Vincent 👋





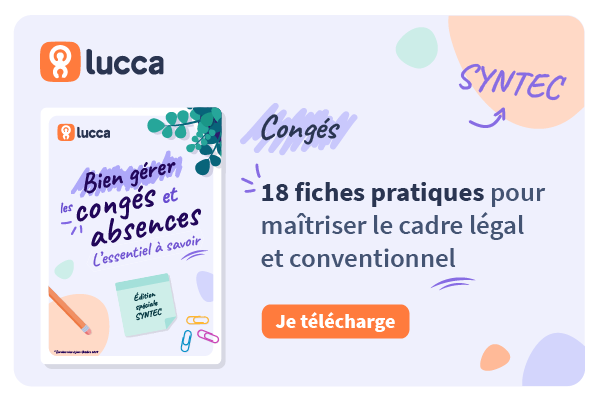


Je vous découvre et j'apprécie le format et la clarté des informations. Merci
Oups message parti.....Donc parler chiffres avec des exemples, actions et résultats seront plus parlant pour un dirigeants.
Votre double casquette est très intéressante !
Si vous avez des autoformations à me conseiller sur la finance et les Rh je suis preneuse.
Bonne journée et merci